Et si on parlait (aussi) des garçons ?
On parle souvent de l’égalité filles-garçons, de la place des filles dans la tech ou dans les filières scientifiques. Mais on oublie parfois que les garçons aussi subissent des injonctions sociales dès le plus jeune âge. “Sois fort”, “ne pleure pas”, “sois performant”, “ne fais pas de danse”… Ces phrases apparemment anodines dessinent une masculinité stéréotypée qui enferme, étouffe, et peut créer un mal-être durable.
Derrière ces stéréotypes, il y a des impacts bien réels sur la confiance en soi, la gestion des émotions ou la capacité à exprimer ses besoins. Cet article propose un décryptage de ces injonctions invisibles et des pistes concrètes pour accompagner les garçons vers plus de liberté intérieure.
Les stéréotypes de genre ne concernent pas que les filles
Un conditionnement précoce… et souvent inconscient
Dès la crèche, certains enfants reçoivent des messages très différenciés selon leur genre. Un garçon turbulent sera “énergique”, une fille agitée sera “difficile”. Un garçon qui pleure ? On lui dira de “se ressaisir”. Une fille qui pleure ? On la consolera.
Les mots ne sont pas neutres. Ils construisent une image de soi. Et ce qu’on dit (ou ne dit pas) aux garçons façonne leur rapport au monde, aux autres, et à eux-mêmes.
Les chiffres qui parlent
Une étude récente menée auprès des 11-17 ans en France révèle :
-
60 % des jeunes estiment que “c’est aux garçons de protéger les filles”
-
58 % pensent que “les garçons sont naturellement plus violents que les filles”
-
33 % jugent qu’“un garçon qui joue à la poupée, ce n’est pas normal”
-
15 % considèrent qu’“un garçon ne doit pas pleurer”
Ces chiffres montrent à quel point certains stéréotypes restent bien ancrés, en particulier chez les collégiens, moment-clé dans la construction de l’identité.
Les injonctions les plus courantes faites aux garçons
1. “Sois fort” : l’illusion de la performance permanente
On attend des garçons qu’ils soient solides, autonomes, compétitifs. Mais être fort en permanence, c’est aussi apprendre à cacher ses fragilités, ses doutes, ses douleurs. C’est un frein à l’expression émotionnelle et à la construction de relations authentiques.
Conséquence : certains garçons, à l’adolescence, n’ont pas les mots pour dire qu’ils ne vont pas bien. Le mal-être peut alors exploser par des comportements violents, du repli ou de la dépression silencieuse.
2. “Ne fais pas ça, c’est pour les filles” : la dictature du genre
Porter du rose, faire de la danse, jouer à la dînette… autant d’activités encore perçues comme féminines. Or, l’interdiction symbolique de ces goûts limite les expériences, les apprentissages, la créativité. Elle entretient surtout l’idée qu’il y aurait des choses réservées à un genre, et d’autres interdites.
Résultat : moins de garçons lisent, moins osent s’exprimer par l’art, moins s’autorisent à explorer des émotions fines. Et ceux qui osent peuvent être moqués, harcelés, marginalisés.
3-“Tu n’es pas un bébé” : la honte de l’émotion
Dès le plus jeune âge, les garçons apprennent à réprimer leurs émotions. Les pleurs deviennent une faiblesse, la tristesse est remplacée par la colère, le doute par le silence.
Et pourtant, la capacité à identifier et exprimer ses émotions est une compétence clé, reconnue comme essentielle par l’OMS pour la santé mentale. Les garçons en sont souvent privés.
Des conséquences concrètes… et durables
Un déficit de compétences psychosociales
Ce conditionnement a un impact direct sur le développement des soft skills :
-
Moins d’intelligence émotionnelle
-
Moins d’empathie
-
Moins de communication authentique
-
Moins de résilience en cas de stress ou d’échec
Autant de compétences pourtant essentielles dans la vie quotidienne, en amitié, en amour, à l’école ou au travail.
Une crise de sens et de représentation
Les garçons d’aujourd’hui grandissent dans un monde en mutation. Les modèles masculins traditionnels ne fonctionnent plus. Mais les nouveaux repères manquent encore.
Et les réseaux sociaux amplifient le phénomène : croyances virilistes, performances physiques poussées à l’extrême, dénigrement des filles… Les algorithmes enferment dans des bulles qui confortent ces stéréotypes.
Que faire en tant que parent ?
1. Observer son propre langage
Les phrases du quotidien comptent. Plutôt que :
-
“Arrête de pleurer”
-
“Ce n’est pas pour toi”
-
“Un garçon, ça ne fait pas ça”
On peut dire :
-
“Tu as le droit d’être triste”
-
“Tu peux aimer ce que tu veux”
-
“Ce n’est pas une question de fille ou de garçon, c’est une question de goût”
2. Ouvrir les possibles
-
Proposer une variété d’activités (sport, art, jeu libre, lecture)
-
Accepter l’exploration : un garçon qui veut cuisiner, danser, pleurer, dessiner des cœurs… a juste envie de s’exprimer
-
Montrer des modèles masculins diversifiés (artistes, pères présents, hommes sensibles, etc.)
3. Renforcer la confiance émotionnelle
-
Valoriser l’expression des émotions
-
Ne pas juger ou minimiser les peurs ou les douleurs
-
Partager ses propres émotions d’adulte (sans surcharge, mais avec authenticité)
4. Agir tôt (et souvent)
La socialisation commence très tôt. Les crèches, les écoles, les livres, les vêtements, les jeux… tout est vecteur de normes. Plus on agit tôt, plus les enfants pourront se construire librement.
Repenser l’éducation comme un espace de liberté
L’objectif n’est pas de nier les différences. Mais de ne pas assigner un rôle à un enfant selon son sexe. Laisser un garçon pleurer, porter du rose, aimer la danse ou détester le foot, ce n’est pas l’éloigner de lui-même, c’est l’en rapprocher.
C’est lui permettre d’explorer, de ressentir, de choisir. Et de devenir un adolescent, puis un adulte, plus libre, plus empathique, plus aligné.
Ce qu’on peut retenir
Les garçons aussi subissent des stéréotypes de genre
Ces injonctions affectent leur développement émotionnel et social
Les soft skills doivent être cultivées dès l’enfance, pour tous
Les parents ont un rôle clé pour élargir les possibles
Il est temps de repenser les modèles masculins
Un changement de société… Au détriment des enfants
Une peur grandissante de l’extérieur
L’un des premiers freins est culturel. De nombreux parents avouent avoir peur de laisser leur enfant dehors. Peurs de l’accident, de l’enlèvement, du regard des autres… Même dans des résidences sécurisées, on n’ose plus les laisser seuls. Or, les statistiques montrent que les dangers ne sont pas plus nombreux qu’avant, mais la perception du risque a explosé.
Résultat : les enfants sont de plus en plus enfermés, parfois moins dehors que les détenus selon certaines études.
Des villes pensées pour les adultes, pas pour les enfants
Autre frein majeur : l’espace urbain. Dans de nombreuses villes, les aires de jeu sont rares, mal situées ou peu adaptées. Ce sont souvent des zones clôturées, imperméables, sans végétation. Elles manquent de vie, de diversité, et n’encouragent ni l’autonomie ni la créativité.
En parallèle, la voiture domine l’espace public. Entre sécurité routière et manque de visibilité, les parents ont du mal à imaginer leurs enfants jouer seuls dans la rue ou traverser seuls le quartier. Tout semble conçu pour des adultes motorisés.
Une pression sociale sur les parents
Dans une société de la performance et du contrôle, laisser un enfant seul dehors est parfois perçu comme un manque de responsabilité. Beaucoup de parents avouent craindre d’être jugés par les voisins ou les autres familles.
❝ Un enfant qui joue seul dehors est parfois considéré comme “livré à lui-même”, voire “délaissé”. ❞
Quelles conséquences sur les enfants ?
Moins de nature, plus de stress
Passer du temps dehors, ce n’est pas juste “prendre l’air”. De nombreuses études ont démontré que le contact avec la nature améliore l’humeur, diminue l’anxiété, renforce le système immunitaire et favorise l’apprentissage.
Dans certains pays comme la Finlande, des programmes ont même permis de réduire significativement les allergies et les crises d’asthme chez les enfants, en leur permettant d’interagir avec un environnement naturel plus riche.
Un impact sur le développement des soft skills
Le jeu libre en extérieur développe de nombreuses compétences psychosociales, précieuses à l’école comme dans la vie :
-
La patience (attendre son tour au toboggan),
-
La coopération (organiser une partie de cache-cache),
-
La résilience (se relever après une chute),
-
La confiance en soi (oser explorer seul un coin de nature),
-
La créativité (inventer des règles, construire une cabane).
À l’inverse, des enfants trop encadrés, privés d’autonomie, peuvent manquer de ressources pour s’adapter et devenir dépendants des sollicitations extérieures (notamment les écrans).
Un creusement des inégalités
Tous les enfants ne sont pas égaux face à l’accès à la nature. 4 enfants sur 5 en France n’ont pas de parc naturel dans leur quartier. Et si certaines familles peuvent compenser par des sorties le week-end, d’autres n’en ont ni le temps, ni les moyens.
Comment y remédier, même sans jardin ?
1. Commencer petit (et régulièrement)
Pas besoin de partir en forêt chaque week-end. 15 minutes par jour dans un parc ou même un bout de trottoir arboré peuvent faire la différence.
L’objectif : intégrer l’extérieur dans le quotidien, comme on intègre l’heure du goûter ou le bain. Marcher jusqu’à l’école, faire un détour par le square, s’asseoir sur un banc pour observer les nuages… Les occasions sont plus nombreuses qu’on ne le croit.
2. Adopter le réflexe slow
Dans une société du “toujours plus vite”, ralentir pour sortir est un acte presque militant. Prendre le temps d’observer une fourmi, de ramasser un bâton ou de sauter dans une flaque, c’est aussi ralentir notre rythme intérieur et celui de nos enfants.
Astuce : adopter une tenue adaptée (bottes, combinaison, vieux pantalon) pour ne plus freiner les envies de jeu sous prétexte de “salir ses habits”.
3. Transformer le regard sur la saleté
“Attention tu vas te salir” : combien de fois l’avons-nous dit ? Pourtant, le contact avec la terre, le sable, les feuilles est essentiel pour le développement sensoriel des enfants. C’est aussi une manière de renforcer leur système immunitaire et leur microbiome.
Laisser son enfant se salir, c’est le laisser explorer.
4. Valoriser l’ennui et la patience
Deux qualités en voie de disparition… et pourtant si précieuses. Le dehors apprend à s’ennuyer (et donc à imaginer), à attendre son tour, à faire avec les autres.
Loin des programmes d’activités millimétrés, le jeu libre développe une forme d’autonomie intérieure. Il prépare l’enfant à la vie, à la gestion de la frustration et à la découverte de soi.
5. Proposer des micro-aventures
Pas besoin d’habiter à la campagne pour partir à l’aventure. Voici quelques idées :
-
organiser une chasse aux trésors dans un parc urbain,
-
apprendre à reconnaître les arbres ou les empreintes d’animaux,
-
construire une cabane avec quelques branches,
-
observer les insectes avec une loupe…
Ces “expéditions” peuvent être très simples, mais elles reconnectent l’enfant au vivant et à son imagination.
Et si on repensait la ville pour les enfants ?
Au-delà des gestes du quotidien, notre environnement doit évoluer. Certaines villes européennes ont déjà adopté une nouvelle vision : créer des espaces de jeu ouverts, végétalisés, pensés pour les enfants… et pour les parents aussi.
Un simple café dans une aire de jeu, des bancs confortables, des toilettes accessibles, et un peu de matériel libre (sable, bois, feuilles, bâtons) suffisent souvent à transformer un quartier.
Ces petits changements favorisent :
-
l’autonomie des enfants,
-
la socialisation spontanée,
-
la réduction de la charge mentale parentale,
-
le sentiment de communauté.
Conclusion : il est temps de remettre la nature au cœur de l’éducation
Les enfants ont besoin de jouer dehors. Pas seulement pour se défouler, mais pour grandir sereinement, développer leur curiosité, leur confiance et leurs compétences comportementales.
Nous, parents, n’avons pas toujours le pouvoir de transformer la ville. Mais nous pouvons changer nos habitudes, réintroduire un peu de vivant dans le quotidien, et surtout lâcher prise sur la boue, le bruit ou les jugements.
Sortir, c’est aussi se reconnecter à soi. Et si on s’autorisait, nous aussi, à marcher un peu plus lentement, les yeux levés ?
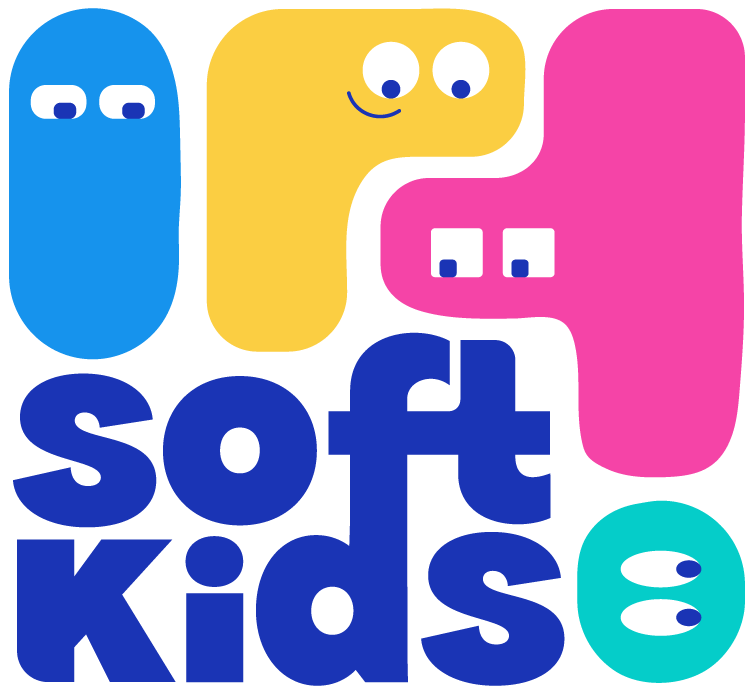



0 commentaires