Ils sont nombreux à s’inquiéter. Et de plus en plus jeunes. Nos enfants entendent parler de climat, d’extinction, de crise, de planète en danger. Ils grandissent dans un monde où l’urgence environnementale est omniprésente, sans toujours comprendre comment y faire face.
Résultat : beaucoup se sentent impuissants, fatalistes, paralysés. On appelle ça l’éco-anxiété.
Mais ce n’est pas une fatalité. Ce mal-être peut se transformer en levier d’action, à condition d’être entendu, reconnu et accompagné.
Pas besoin d’être expert en climat ou militant convaincu pour faire la différence. Il suffit d’écouter, d’outiller, et de montrer que, même à 12 ans, on peut déjà changer les choses.
L’éco-anxiété, c’est quoi exactement ?
Ce n’est pas un caprice. Ni une mode. C’est une anxiété réelle face à l’avenir de la planète. Les jeunes se sentent à la fois informés et impuissants. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
79 % des 15-25 ans considèrent que l’environnement est une priorité dans leur vie
Mais seulement 9 % s’engagent concrètement dans une action écologique
7,9/10 : c’est le niveau moyen d’éco-anxiété exprimé par les jeunes dans une étude nationale
Ils savent. Mais ils ne savent pas quoi faire. Ou pensent qu’il est déjà trop tard.
Et si on arrêtait de leur faire peur ?
À force de messages alarmistes, on finit par les décourager. Le climat n’est pas un film catastrophe, c’est un sujet d’éducation. Si on veut qu’ils s’engagent, on doit changer le récit.
Plutôt que de leur dire que tout va mal, montrons-leur ce qu’ils peuvent faire :
-
Agir à leur échelle
-
Poser des questions
-
Développer leur esprit critique
-
Proposer des solutions, même petites
Comment on passe de l’angoisse à l’action ?
L’école a un rôle à jouer. Mais les parents aussi. Pas besoin d’attendre les cours d’éducation morale ou les projets d’établissement pour parler d’écologie à la maison.
Voici ce qui fonctionne :
1. Partir de leur quotidien
Tu veux l’impliquer ? Commence par des choses concrètes :
Comment choisir un téléphone plus responsable ?
Pourquoi limiter le streaming ?
Est-ce que ses applis ou ses jeux consomment beaucoup d’énergie ?
Que faire avec un vieux smartphone ?
Chaque usage numérique est une porte d’entrée vers une discussion écologique.
2. Transformer l’éducation en expérience
Les projets les plus efficaces sont ceux qui ressemblent à leur vie. Jeux, vidéos, défis, discussions… L’éducation ne doit pas être une leçon de morale, mais une aventure engageante.
Et ce n’est pas réservé à l’école. À la maison, vous pouvez aussi :
Choisir ensemble un objectif écolo pour la semaine
Décortiquer les pubs sur les réseaux (greenwashing, vrai/faux engagement…)
Chercher un influenceur ou un artiste engagé qui lui parle
3. Parler sans imposer
Là encore, l’écoute prime sur le contrôle. Vous n’êtes pas là pour surveiller s’il trie ses déchets ou s’il éteint les lumières. Mais pour lui donner envie de comprendre l’impact de ses gestes.
Et si on valorisait les petits engagements ?
Beaucoup de jeunes pensent qu’il faut être activiste, végétarien, ou monter une association pour « faire quelque chose ». Non. L’engagement peut être simple et personnel :
-
Être éco-délégué dans son collège
-
Participer au World Cleanup Day
-
Proposer une journée sans plastique à l’école
-
Rapper, danser, dessiner sur le climat
-
Sensibiliser ses copains aux bons gestes
Ce qui compte, ce n’est pas la taille de l’action, mais la prise de conscience.
Et nous, les parents, on fait quoi ?
On montre l’exemple. Et on reste cohérents. Car oui, il est difficile d’interdire TikTok quand on est soi-même accro à Instagram. De parler sobriété numérique quand on allume Netflix tous les soirs. Ou de faire la morale sur les achats quand on reçoit trois colis par semaine.
Mais pas besoin d’être irréprochable. Il suffit d’être honnête.
Voici quelques repères utiles :
- Discuter de ses propres doutes ou contradictions
- Impliquer les enfants dans vos choix écologiques (courses, déplacements…)
- Montrer comment on peut consommer différemment, sans priver
- Apprendre ensemble (documentaires, podcasts, discussions…)
Ce que l’on retient
-
L’éco-anxiété touche les jeunes de plus en plus tôt
-
Ils ont besoin d’espace pour comprendre, pas de pression pour changer
-
L’engagement peut être ludique, créatif, progressif
-
Le rôle des parents est central, pas pour enseigner, mais pour accompagner
-
Le lien fait plus que le contrôle. L’exemple plus que les discours.
Et surtout :
Un enfant écouté, encouragé, valorisé dans ses idées… deviendra un adulte engagé.
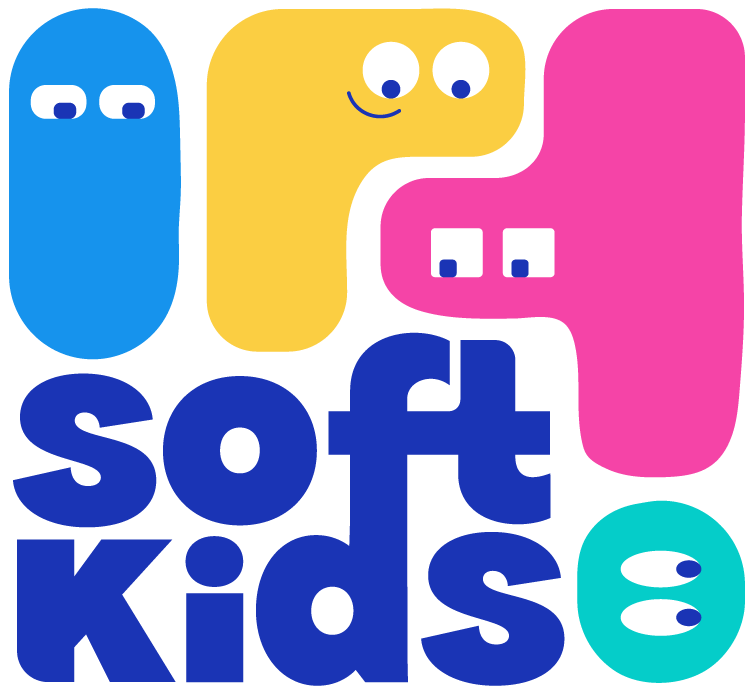



0 commentaires